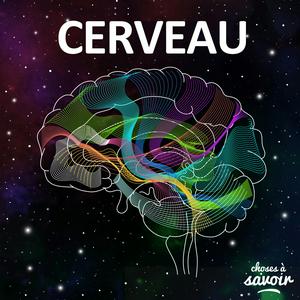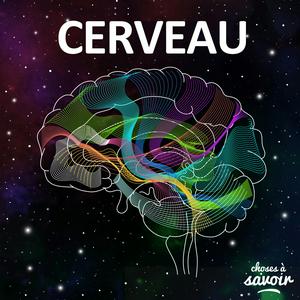L’anxiété est l’un des troubles psychiques les plus répandus au monde. Palpitations, hypervigilance, pensées envahissantes, sensation de danger permanent… Ces symptômes semblent multiples, complexes, et leurs causes longtemps restées floues. Mais une étude récente ouvre une piste radicalement nouvelle : et si une partie de l’anxiété avait une origine biologique unique, identifiable, et potentiellement modulable ?
Des chercheurs de l’Institut des neurosciences de San Juan, à Alicante, en Espagne, se sont intéressés à un gène précis : Grik4. Ce gène code une protéine du système nerveux central impliquée dans la transmission du glutamate, le principal neurotransmetteur excitateur du cerveau. Autrement dit, Grik4 joue un rôle clé dans la manière dont les neurones communiquent entre eux.
Leurs travaux, publiés dans la revue scientifique iScience, montrent un phénomène frappant : lorsque le gène Grik4 est surexprimé, le cerveau entre dans un état d’hyperactivité anormale, très proche de ce que l’on observe dans les troubles anxieux.
Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont étudié des modèles animaux chez lesquels l’expression de Grik4 était artificiellement augmentée. Résultat : ces animaux présentent des comportements typiques de l’anxiété – évitement excessif, réactions de peur exagérées, difficulté à s’adapter à des environnements nouveaux. Sur le plan neuronal, leur cerveau montre une activité excitatrice excessive, comme si les circuits de l’alerte restaient bloqués en position “danger”.
Pourquoi est-ce crucial ? Parce que l’anxiété est souvent décrite comme un déséquilibre entre les systèmes d’excitation et d’inhibition du cerveau. Cette étude suggère que Grik4 pourrait être l’un des interrupteurs moléculaires de ce déséquilibre. Trop actif, il pousserait le cerveau à interpréter des situations neutres comme menaçantes.
Les chercheurs avancent une hypothèse forte : dans certains troubles anxieux, le problème ne serait pas seulement psychologique ou environnemental, mais lié à une dérégulation précise de la signalisation glutamatergique. Cela ouvre la voie à des traitements plus ciblés, visant non pas à “calmer” globalement le cerveau, mais à rééquilibrer un mécanisme moléculaire spécifique.
Attention toutefois : il ne s’agit pas de dire que toute l’anxiété se résume à un seul gène. Les troubles anxieux restent multifactoriels, mêlant génétique, environnement, expériences de vie et apprentissages émotionnels. Mais cette découverte apporte une pièce majeure au puzzle.
Elle rappelle surtout une chose essentielle en neurosciences : parfois, derrière un tourbillon de symptômes complexes, se cache un mécanisme étonnamment précis. Et c’est souvent là que naissent les avancées thérapeutiques les plus prometteuses.
Hébergé par Acast. Visitez acast.com/privacy pour plus d'informations.